Comme il en est désormais coutume, Making Of s’est rendue cette année au Festival de Cannes pour l’accompagner fin mai dans les derniers jours de sa 75ème édition. L’occasion, en plus d’y profiter de l’air méditerranéen, d’enchaîner lors de journées bien remplies des films plus ou moins appréciés. Vous pourrez retrouver au fil de cet article des conseils prodigués par les membres de Making Of, au travers de textes déclamant toujours un peu d’amour pour le cinéma.
Armageddon Time, par Victor Bletton
Armageddon Time suit le parcours de Paul Graff, jeune garçon qui grandit dans le Queens dans les années 1980. Paul va à l’école, fait rire ses camarades, répond à son professeur, à sa mère, découvre Kandinsky, et est envoyé dans une école privée. Comme dans Les 400 coups de Truffaut (le premier film que James Gray a montré à ses enfants pendant le confinement) le jeune homme apprend en faisant des bêtises, mais également en observant et en écoutant les autres. En suivant les traces de Paul et son évolution psychologique James Gray ne se contente pas de réaliser un film sur un garçon ou sur la jeunesse mais sur la vie, son lot de joies, de beautés mais aussi d’injustices et de désillusions, face à un monde ou la richesse triomphe et entraîne avec elle les privilèges.
La réelle beauté du film réside dans le traitement complexe et jamais simplificateur de thèmes simples et accessibles à tous. En racontant de manière déguisée sa propre histoire le réalisateur nous livre une œuvre très intime, qui par là même devient universelle. On peut tous reconnaître dans le personnage d’Anthony Hopkins, auteur d’une interprétation comme souvent remarquable, un grand père, humaniste et courageux, qui ne transigera jamais face aux injustices même si la défense de sa famille s’imposera parfois comme une nécessité qui passe avant tout, lui qui a connu dans sa jeunesse le mal absolu.
Par son réalisme, tant au niveau du développement des personnages que du traitement naturaliste de l’image, sobre mais somptueux de Darius Khondji, le film bouleverse, de bout en bout, sans pour autant forcer l’émotion du spectateur. James Gray filme la vie, la sienne, la nôtre, et cette réflexivité laisse peu de spectateurs de marbre.
Sortie le 09 novembre 2022.

Boy from Heaven, par Sam Benmayor
Dans un festival de Cannes qui aura fait la part belle aux métrages décrivant les horreurs de l’islamisme et de ses conséquences (citons notamment Holy Spider, Rebel ou Novembre), Boy from Heaven apparaît comme une respiration bienvenue, celle nécessaire à l’entame d’une réflexion préférant la subtilité au sensationnalisme. Le dernier film de Tarik Saleh, à juste titre auréolé du prix du scénario, brosse en effet un tableau complexe des relations équivoques qu’entretiennent politique et religieux dans l’Égypte contemporaine, sur fond de guerre de succession suite à la mort du grand imam sunnite de la prestigieuse université théologique d’al-Azhar que vient d’intégrer le héros.
Questionnant la place objective du politique dans l’islam par la mise en scène de querelles de chapelles mystiques, pragmatiques ou encore salafistes, mais aussi des relations conjoncturelles qu’ils peuvent ou devraient entretenir dans l’Égypte dictatoriale d’al-Sissi, le film met en place une véritable dialectique conceptuelle dont les termes s’affrontent ou se rejoignent dans une tension continuelle. A ce titre, on ne peut que saluer le fait d’avoir donné à cette tentative la forme d’un thriller, forme cinématographique excellant à faire sentir, et non seulement comprendre, cette tension tangible pouvant exister entre des concepts dès lors libérés de leur abstractivité. Pensons à Basic Instinct de Paul Verhoeven, qui a fait dialoguer sexe et violence ou encore à La Nuit nous appartient de James Gray qui articule le couple devoir et liberté.
Plus largement, le film tente de dresser un tableau des différentes tentatives de concilier une vie dédiée à la pratique et à l’étude coranique d’une part, et la nécessité de prendre en compte son être au monde dont la négation ne pourrait être qu’un déni voire même un blasphème en tant que reniement de son humanité d’autre part. Le métrage dresse ainsi une galerie de personnages faisant le choix de l’intransigeance, du compromis ou de la compromission, en tout cas sentant tous l’urgence de cette tension difficilement soluble.
Malgré une mise en scène peut-être trop sobre et classique pour être en elle-même suffisamment signifiante, le film parvient néanmoins à se dégager d’un pur intellectualisme par sa galerie de personnages à l’humanité réelle quoi que souvent empêchée ou dissimulée sous la contrainte. Le personnage principal en est le symbole, jeune candide ignorant tout des vicissitudes de la capitale et qui fera de ses ballotements forcés entre les différents courants qui tentent d’accroître leur influence dans l’université un parcours initiatique dont le terme sera le choix de sa propre attitude existentielle, une articulation neuve du transcendant et de l’immanent comme un signe qu’il n’est plus un élève mais enfin son propre maître.
Sortie le 09 novembre 2022.

Broker, par Luca Mongai
Au soir du dernier jour cannois, c’est dans un état presque second que d’irrésistibles spectateurs accueillent encore un peu des images festivalières. A chacun les siennes, qui les emportera par-delà la croisette. Pour moi, ce furent des cadres tendres et savamment composés, déchirés çà-et-là par des plans de pur cinéma ; des personnages légers, dit-on, mais tout clairsemés dans le fond de tristesses indésirées ; des contrées pensivement tranquilles et qu’on croirait elles-mêmes désolées pour ceux qu’elles enlacent.
Enième variation sur les thèmes chers à l’auteur, paraît-il, mais c’est qu’un artiste qui varie cherche éperdument la note juste. Dans Broker, Kore-Eda déploie sa petite musique, toute de finesse et de grâce vêtue, avec une agilité dont l’évidence désarme autant qu’elle émeut. On le dit souvent du cinéaste, que la délicatesse de son regard fait tout dire à des petits riens, que le calme de ses plans fixes n’a d’égale que la tendresse qui s’en dégage. Des ouvertures laissées partout, dans les mots, les regards, les gestes, détails patiemment disposés qui viennent sculpter toute scène entrevue. Une femme dans sa voiture arrêtée, qu’auréolent discrètement la lumière jaune-orangée du lampadaire et la pluie qui vient ; sa conversation à demi-perçue, avec au bout du fil ce que l’on devine un compagnon, et dans le fond qui profile, Wise up, chanson d’un autre film aimé, remémoré. Des presque-riens donc, presque, puisqu’avec eux se raniment tout un imaginaire, une épaisseur inopinée qui rappelle en chacun l’émotion du possible, de l’éventuel éveillé : des amours peut-être déçues, peut-être lointaines, ou seulement fatiguées ; des lassitudes refermées, des chagrins qui couvent au loin ; tendresses presque somnolentes, peines du quotidien.
Broker est semblable aux contrées calmes qu’il déploie, traversées par des bandes de lumière douces ; de sa finesse émue, il n’éblouit pas, il éclaire. Sa légèreté d’apparence, réelle, délicieuse, rend par contraste d’autant plus profonde la mélancolie qui profile. Les traits d’humour délicats, bienvenus, parsèment l’ouvrage d’une innocence presque naïve, mais qui ne saurait trahir dans le fond le chagrin qui l’anime. Sa langueur est calme, docile, s’apprivoise tranquillement. Reste qu’au sortir de la salle vint me prendre une euphorie douce-amère, presque triste elle-même car encore mêlée de la mélancolie restante. Appréciant les lumières tout juste tombées sur la croisette, la mer doucement bariolée de reflets cannois, j’avais un peu l’esprit ailleurs, l’air vaguement distrait, reclus encore dans les profondeurs douces et tristement paisibles entrouvertes par Kore-Eda.
Sortie le 07 décembre 2022.

Close, par Louise Nisol
Si on vous demandait de donner la recette parfaite pour un drame touchant, quels ingrédients conseilleriez-vous ?
Pour ma part, je décrirais un scénario touchant comme une histoire dans laquelle il n’y ni gentil, ni méchant. Une histoire dans laquelle les personnages sont tragiquement liés et irrémédiablement destinés à se faire du mal malgré tout l’amour qu’ils se portent. Et c’est précisément pour cette raison que Close de Lukas Dhont mérite son Grand Prix.
De plus en plus nombreux sont les films à caractère « LGBTQ+ friendly ». Après des œuvres allant de Sex Education à Call me by your name, il n’était pas évident de savoir à quoi s’attendre au moment de l’entrée en salle. Cependant, récompensé par la Queer Palm, Close est en fait la démonstration parfaite de la façon dont les jeunes continuent de souffrir de leur sexualité.
Léo et Rémi sont deux jeunes de 13 ans liés d’une amitié si profonde qu’elle brouille la frontière même entre amour et affection. C’est là où les jeux d’Eden Dambrine (qui joue Léo) et de Gustav De Waele (Rémi) sont remarquables : via l’intensité de leurs regards, ils perdent ceux qui suivent leur histoire quant à la nature de leur relation.
Les interrogations des spectateurs sont visiblement partagées par les personnages secondaires. Les camarades de classe des deux amis ne cessent de les tarauder de questions – pour les plus polis d’entre eux – voire de proférer des remarques homophobes à leur égard. Mais Léo, lassé qu’on lui attribue une sexualité hors de la norme dont il ne veut pas, finit par violemment rejeter l’amitié de Rémi pour intégrer le cercle des plus populaires.
Spoilers. Rémi, quant à lui, abandonné par la seule personne qu’il adorait, finit par se suicider. Le long métrage traite donc tout aussi brillamment dans une deuxième partie de la thématique du suicide et de la façon dont chacun surmonte le vide créé par la mort d’un proche. C’est le cœur serré d’émotion que nous suivons, non seulement Léo mais également toute la famille de Rémi, luttant contre la culpabilité ou l’incompréhension que suscite le recours au suicide.
Sortie le 01 novembre 2022.

La Femme de Tchaïkovski, par Audrey Brithmer
Une rencontre inattendue mais réussie ! Non pas celle entre Piotr Tchaïkovski et son infortunée épouse, Aliona Mikhaïlova, qui se pourrit d’amour pour le compositeur au point d’en perdre la raison, mais entre Kirill Serebrennikov et moi.
Après Leto et La fièvre de Petrov, le cinéaste russe revient à Cannes pour nous plonger dans la Russie du 19ème siècle où l’on y suit l’histoire d’amour à sens unique entre Tchaïkovski et sa femme. Pourtant dès les premières minutes du film, alors que le compositeur, tel un esprit vengeur, ressuscite de son lit funéraire afin de se lancer dans un bref réquisitoire contre sa femme, l’on comprend qu’il ne s’agit pas d’un simple long-métrage d’époque mais d’une plongée dans la propre virtuosité démentielle du cinéaste. On se laisse alors emporter par les plans séquences vertigineux, l’agréable bande originale, la mise en scène quasi-picturale mais aussi les scènes qui viennent nous surprendre par leur contenu et leur exécution.
Néanmoins alors que cette longue descente aux enfers est amorcée dès les prémisses de cette relation, car celle-ci servant d’alibi pour le compositeur d’une part et de trophée pour sa femme d’autre part, comment fait-on pour ne pas suffoquer face à la longueur du film ? Sans doute grâce à la performance des acteurs, à leur folie contagieuse. L’essentiel des scènes ayant lieu en appartement, le jeu des acteurs, notamment celui de l’époustouflante Antonina Miliukova, qui grime avec perfection les traits d’une femme malade d’amour, devient la carte maîtresse d’un film à la trame attendue. Ainsi les sentiments, la frustration, la colère d’Aliona Mikhaïlova se mettent à raisonner en nous et sa démence nous fait écho. Folie, folie quand tu nous tiens ! Sans doute est-ce là le tour de force de ce sombre long-métrage, lever le voile sur une histoire méconnue afin de l’enfouir davantage dans les ténèbres sans pour autant se perdre dans l’excessivité.
Finalement, entourée de mes camarades endormis de fatigue par ce marathon cannois, je me suis pris une véritable claque devant ce film que je n’attendais pas. Le talent de Serebrennikov m’a surpris et a fait naître en moi une fascination nouvelle. Serons-nous les Tchaikovski et Mikhaïlova des temps modernes ? Enfin je n’espère pas ….
Date de sortie non précisée.

Godland, par Armand Fevelat
Pour se rendre dans le village islandais dont il doit devenir le pasteur, et construire une église de bois, coque de navire inversée, un prêtre danois décide de ne pas arriver par la mer, mais de traverser les étendues glacées de l’île, pour la comprendre et capturer des événements de la vie des hommes et des saisons grâce à une invention importée d’Europe, la photographie. Mais le prêtre se retrouve vite seul face à la nature et ses enfants, les fils de l’Islande qu’il voit comme des rustres et qui lui servent de compagnons de route, dont il ne peut se passer.
Ce film, dont le synopsis séduira peut-être les plus puristes, est fidèle à lui-même : s’il ne faut pas avoir peur d’un premier plan – monologue sur les mille noms que peut porter la neige – il ne faut pas non plus avoir peur des neuf cent quatre-vingt dix neuf plans suivants, cadrés sur le même paysage et sur les formes qu’il peut prendre sous la neige, qui montrent à la fois la différence du temps et des activités des vivants, et la permanence de la nature.
La grande force de cette œuvre est sa capacité à placer ses personnages face à l’immensité, qu’elle soit spatiale ou temporelle, les faisant défiler dans des paysages immenses et ouverts qui persistent dans le temps quand, du point de vue des hommes qui y évoluent, tout se transforme et condamne les grands projets, qu’ils soient spirituels ou temporels.
Les relations entre les personnages montent progressivement en tension, ce qui permet de se laisser happer par le film, d’être saisi par ses brefs éclats, ses scènes de guerre et de paix entre les hommes. Mais l’image posée, soignée, nous laisse aussi profiter, avec les personnages, des instants de répit que se permet le film, qui se permet de tout montrer, du plus beau au plus laid. Mais ce qui persiste dans le paysage et dans la mémoire du spectateur, c’est évidemment la beauté.
Sortie le 21 décembre 2022.

Pacifiction, par Joffrey Liagre
Sous la moiteur exotique de Tahiti naissent d’étranges rumeurs à propos d’essais nucléaires. Un détachement de militaires débarque sur l’île, mené par un amiral burlesque. En réponse à l’hypothétique menace, les habitants préparent leur révolte. Coincé entre deux feux, le Haut-Commissaire De Roller déambule d’une scène à l’autre, d’un bar à un hôtel, autant pour contenir le chaos que pour en comprendre la nature. Benoit Magimel y incarne ce représentant d’état nonchalant, superbe dans son costume blanc immaculé. Il est de presque toutes les scènes, perdu dans ce conflit aux contours flous. Petit à petit, l’illusion de son pouvoir s’effrite, et sa parole accommodante ne suffit plus à stopper la déliquescence du monde qui l’entoure.
Décrire Pacifiction est un exercice périlleux, le film ne ressemblant à rien d’autre qu’à lui-même. De longs dialogues s’étirent jusqu’à leur point de rupture, mise en scène des boniments de la politique où les phrases se répètent, où l’on retombe sur les mêmes mots, où l’on raconte parfois n’importe quoi. Le calme pragmatique de ces bavardages diplomatiques touche une forme d’absurde lorsqu’elle se confronte à cet apocalypse diffus que tous voient venir mais que personne ne peut nommer. Albert Serra observe le lent effondrement du pouvoir, la mise à nue de son illusion. S’il dit incarner le gouvernement, De Roller est seul, voguant dans cette atmosphères enivrante, tentant autant que faire se peut de conserver sa position.
L’opération, entrecoupé d’un vol en avion et d’une fantastique session de jet-ski, est proprement fascinante. Elle le devient plus encore dans ses quarante-cinq dernières minutes lorsque la voix s’éteint et que les visions surréalistes remplacent le langage. Ce long dénouement qui ne fait qu’opacifier encore un peu plus les enjeux plonge l’île dans une obscurité crépusculaire, comme si la fin du monde était enfin venue. La folie finale achève de placer Pacifiction comme le film le plus abouti du festival, mais aussi le plus sidérant et inattendu. Rien ne prépare à son visionnage, à cette chute inexorable dans la démence, à cette plongée vertigineuse dans un ailleurs conradien.
Sortie le 09 novembre 2022.

Rebel, par Yan Balanger
Rebel est une expérience cinématographique avant tout sensorielle destinée à perturber et choquer. Nous pouvons d’abord penser que le projet du film est osé – aborder un thème aussi sensible que le terrorisme islamiste dans une société déjà divisée par cette question. Mais le film n’adopte pas une position politique qui pourrait être considérée réactionnaire – le film essaie de dévoiler avant tout la réalité de la guerre en Syrie, et il s’aventure dans les causes du conflit qui remontent au terrorisme pratiqué par une infime portion fanatique des musulmans. Or, le film montre que ce sont d’abord les musulmans les premières victimes de ce terrorisme, et non pas la civilisation européenne ou bien l’Occident. Le film baigne dans cette culture, que ce soit à cause des paroles ou des musiques en arabe, et il nous met directement en contact avec elle.
Mais si Rebel est selon moi grandiose, c’est que c’est avant tout la manifestation du point de vue d’un tempérament sur la réalité. Le film est dynamique, brutal, et en même temps musical. Les musiques, les danses et le contenu sous-jacent de ces derniers sont puissants, libérateurs et oppressants à la fois. On s’attache rapidement aux personnages, que ce soit pour les aimer ou pour les détester. Cette forme artistique rentre en contraste avec le contenu véhiculé, mais c’est précisément ça ce qui donne toute la force au film. C’est un film qui fera parler, qui divisera le public également, mais qui mérite d’être vu.
Sortie le 31 août 2022.

Revoir Paris, par Baptiste Gaudeau
Parler d’un film devant lequel on a flirté avec Morphée, ce n’est ni un argument de vente ni une preuve de respect. Heureusement, Cannes pardonne tout, même somnolences et ronflements.
Revoir Paris nous raconte comment Mia, après avoir survécu à un attentat dans un bar parisien selon des circonstances volontairement proches de celles du 13 novembre, tente de reprendre le cours de sa vie. Après 3 mois de cicatrisation laborieuse, elle décide de mettre fin à son amnésie post traumatique en retrouvant d’autres rescapés de l’attaque.
Confrontée à leurs souvenirs épars, elle tisse une nébuleuse de récits contradictoires dans laquelle elle s’égare sans renouer avec quoi que ce soit. Vagabonde de son propre esprit, elle parcourt les méandres parisiens comme les couloirs de sa mémoire, à tâtons. Rompu par mon manque de sommeil, c’est avec le même étourdissement que j’ai suivi sa quête. Attentif par intermittence, j’ai du bricoler ma propre continuité, apprendre à faire avec une narration à trous. Pour une fois j’étais mis sur un pied d’égalité avec un long métrage. Pour une fois, j’éprouvais le film, je ne le traversais pas passivement. C’est peut-être comme ça que je suis tombé amoureux.
De Virginie et Benoît, d’abord, puis du film dans la foulée. Leurs personnages déambulent sans autre bagage que sa veste en cuir pour l’une, ses béquilles pour l’autre. C’est ainsi dépouillés qu’on les découvre. Astres éteints de la nuit parisienne, privés de centre de gravité, ils ne peuvent revenir aux relations satellitaires d’antan. Un soir, leurs trajectoires respectives convergent pour un moment d’amour rare. Perçant leur intimité avec pudeur, la caméra sublime les cicatrices, chaque caresse rappelant que les plaies se referment mais ne disparaissent pas. Quoi qu’il arrive, la blessure est un déchirement. Mais la vie n’est pas faite d’une seule pelote. Plutôt que de renouer avec le fil sectionné de l’existence, il s’agit de dérouler le suivant.
Sortie le 07 septembre 2022.

Stars at Noon, par Eléonore Desjonqueres
Stars at Noon est une adaptation d’un roman éponyme de Denis Johnson, dont l’action se situe dans la moiteur languide du Nicaragua, réalisé par Claire Denis, et a remporté le Grand Prix à Cannes 2022 ex-aequo avec Close.
D’abord, il faut souligner la très jolie performance de Margaret Qualley. On retrouve dans ce film un grain de folie qui lui est propre, ce côté bohème-hippie-rien à foutre qu’elle avait déjà dans le dernier Tarantino Once Upon A Time in Hollywood. Trish, c’est le portrait d’une survivante, d’une femme intrépide, qui n’hésite devant rien pour se protéger. Cette journaliste (qui se nourrit exclusivement à base de rhum), essaye tant bien que mal de se trouver une place dans le pays, à la fois difficile et dangereux. Au fond du gouffre, elle se tournera alors vers son sauveur, sa porte de sortie, celui qui la sortira ENFIN de ce taudis : Daniel (un riche Englishman venu ici pour faire du business). En fait, lui aussi est en danger, mais il ne le sait pas encore. Daniel est un personnage intéressant, de par le fait qu’on ne sait quasiment rien de lui. On sait simplement qu’il travaille pour des gens puissants, qu’il est marié, qu’il a un côté un peu niais par moments et qu’il cache un énorme gun dans sa trousse de toilette. Pourtant, on l’aime bien quand même (mais on ne sait pas trop pourquoi). Ils vont ensemble chercher à repartir aux Etats-Unis, et c’est épuisée mais motivée que notre joyeuse bande de lurons se décide à partir pour une longue (très longue, trop longue?) et folle aventure pleine de challenges.
Petit regret (oui, il y en a un, il faut l’avouer) : Robert Pattinson, qui aurait dû jouer originellement le rôle de Daniel, mais en raison de son emploi du temps chargé (snif), il laisse finalement la place à Joe Alwyn, notre beau gosse à la belle chevelure blonde et soyeuse. R. Pattinson, archétype du brun ténébreux, aurait définitivement donné plus de mystère au personnage (et un petit supplément de charisme). On aurait pu voir un duo, deux forces égales qui se répondent, alors qu’ici, Margaret fait de l’ombre à son partenaire de jeu.
Enfin, ce film se veut très réaliste. Il est, par exemple, ancré dans le contexte de la pandémie du Covid (masques, tests, restrictions sanitaires… : tout est présent). On nous sort complètement de la fiction, et on y croit. Bref, on sent la chaleur d’Amérique latine, une tension permanente, la sueur, le stress, cette ambiance qui nous pèse dessus du début à la fin, on est complètement happé et c’est ce qui est beau.
Date de sortie non précisée.

Tori et Lokita, par Adrien Gredy
À l’issue de la cérémonie de clôture de la 75ème édition du festival de Cannes, le jury présidé par Vincent Lindon accorde à Tori et Lokita le Prix Spécial du 75ème, prix, certes quasi-fictif, mais qui a le mérite de consacrer le magnifique film des frères Dardenne. Le duo belge réalise une nouvelle fois un drame social poignant, porté par des acteurs d’une justesse rare. Le jeune Tori (Pablo Schils) et une adolescente du nom de Lokita (Joely Mbundu), arrivés seuls du Bénin, vivent difficilement en Belgique. Les deux jeunes protagonistes doivent rembourser les passeurs qui leur ont permis l’arrivée dans leur pays d’exil, tout en envoyant régulièrement de l’argent à leurs familles. Le transport de la drogue aux nombreux clients devient ainsi leur tragique moyen de subsistance.
À plus d’un titre, l’œuvre des frères Dardenne se distingue. Évidemment, le scénario, d’un réalisme glaçant et d’une tristesse si touchante, est incroyablement prenant. Combiné à la courte durée du film, le film est particulièrement bien rythmé, ce qui accentue la force de la descente aux enfers de Tori et Lokita. Dès la première scène, le jeu d’acteur révèle la dureté des épreuves qu’ont connues et que vont connaître les deux personnages tout au long de leur vie. On y voit Lokita, angoissée, se faire interroger pour obtenir la nationalité belge qui lui faciliterait immensément la vie et lui permettrait de devenir aide-ménagère, comme elle le souhaite, pour assurer un revenu stable à elle et Tori. Le cuisinier d’un restaurant italien, qui les paye (une misère) en l’échange du transport de différentes drogues, incarne à lui seul le quotidien tragique des deux personnages, partagé entre abus récurrent et indifférence permanente.
Si certains peuvent considérer le jeu d’acteur trop cru voire trop froid (alors que c’est cela qui le rend si profond) ou penser que l’origine de la relation entre les deux protagonistes est traitée trop rapidement, personne ne sort indemne à l’issue du visionnage de Tori et Lokita. Le jeune Mamoun, un inconnu qui a eu la chance de partager la séance avec moi, peinait à cacher ses émotions et son désarroi face aux injustices de la vie de deux jeunes âmes si attachantes. Comme nous tous.
Sortie le 05 octobre 2022.

Triangle of Sadness, par Mamoun Scally
… ou The Square of cynicism. Ruben Östlund a encore frappé. 5 ans seulement après l’obtention de sa première Palme d’or pour The Square, le réalisateur réussit un nouveau tour de force cette année, régalant les audiences cannoises de Triangle of Sadness, une comédie à l’humour aussi tapageur que satirique.
Entamant son film avec douceur en s’attaquant à la cible facile de la fashion et des influenceurs, Östlund ne tarde pas à élargir son champ de tir pour fustiger la haute bourgeoisie et les ultra-riches.
Le spectateur suit la relation de Yaya et Carl, deux influenceurs Instagram à des stades quelque peu différents de leur carrière, ce qui suscite des conflits autour de sujets intimes tels que l’argent. Difficile est de ne pas porter un regard amusé sur les deux protagonistes qui échangent des paroles acerbes, Yaya déclarant ouvertement que leur relation est “good for business”. La croisière qui leur est offerte sur un plateau d’argent leur permettra de côtoyer des richards aux backstories toujours plus grotesques et une appétence quasi-caricaturale pour le caviar et le champagne.
Woody Harrelson, dans le rôle du capitaine ivrogne, nous délecte alors de scènes hilarantes où son personnage lance des débats politiques de façon inopinée, se révélant ouvertement marxiste, et marque alors une vraie opposition au reste des passagers du yacht en plein naufrage. Pourtant, tous les personnages nous semblent bien sympathiques et le film parviendrait (presque) à nous faire ressentir de la peine pour les mille et un soucis qu’ils traversent.
Les scènes qui compensent leur caractère fictif par un réalisme certain enrobent d’une aura inqualifiable un film dont l’aspect dramatique nous fait totalement rire, là où on souhaiterait presque qu’il nous émeuve ! A l’image de Snow Therapy, récompensé du Grand Prix “Un certain regard” en 2014, Triangle of Sadness joue une nouvelle fois avec les émotions du public, forçant quasiment une culpabilité de rire devant ces séquences tragi-comiques.
Le film n’en est pas moins jouissif ; et notre rire n’en est pas moins purificateur dans la mesure où il marque une véritable prise de distance face à ces personnages si étonnants et… östlundiens. Le renversement de la hiérarchie sociale dans le dernier acte crée une réelle sensation de justice dans un contexte où tous ces dignitaires se retrouvent dépouillés de leurs richesses et ramenés à un véritable état d’aequalitas.
L’humour décalé comme tonalité constante dans le script, cumulé à des moments de fou rire absolu, saura ravir à la fois les amateurs d’humour absurde et les publics plus difficiles, générant une satire sociale hilarante qui ne perd rien de son côté poignant.
Et comme dans ses précédents films, le réalisateur nous laisse face à une fin brusque et abrupte, révélant un sentiment d’incomplet, d’inachevé; mais peut-on réellement lui en vouloir ? Les films d’Östlund ne sont que des morceaux de vie après tout.
Sortie le 28 septembre 2022.


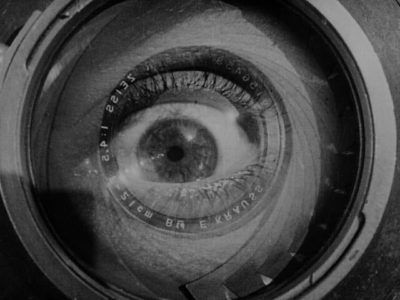





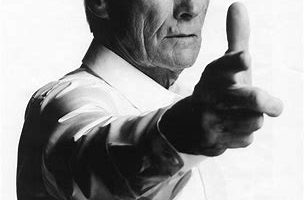







Comments