Par une nuit pluvieuse, deux silhouettes coiffées d’un chapeau et engoncées dans leur trenchcoat au col relevé attendent au coin de la rue. Pas un bruit aux alentours, les abords du bar ont été désertés il y a longtemps déjà par les passants. Soudain, un bruit, deux coups de feux, et les deux silhouettes gisent maintenant à terre. Au loin, une voiture s’éloigne. Le calme n’aura été que momentanément troublé.
Le film de gangsters est reconnaissable entre mille, codifié à l’extrême tant par ses enjeux que par ses décors. C’est donc tout naturellement qu’une ville plus que toute autre en est devenue la scène et que New York se révèle en fantasmes d’allées sombres, bouches d’aérations fumantes et cadavres rougeâtres.
La trace du gangstérisme cinématographique sur New-York est unique en son genre, parce que pour la première fois peut-être dans cette série d’articles, c’est elle qui façonne le mythe new-yorkais et non l’inverse. Mean Streets, réalisé par Martin Scorsese, est un monde de néons, de coins de rues, de bars douteux, dans lequel la violence des relations humaines accompagne les amitiés.
Néanmoins, Mean Streets revêt paradoxalement les atours d’un buddy movie, signe déjà que la portée du film de gangsters dépasse de très loin l’évidence de l’atmosphère, du crime et de quelques acteurs incontournables, Robert de Niro et Harvey Keitel en tête. Entre jeu d’affirmation personnelle, rapport ambigu à la violence et humanité incompatible avec la poursuite d’activités mafieuses, il témoigne d’une ambiguïté qui fait la sève du genre et qui trouve dans son cadre de Little Italy un écho particulier.

Cette multiplicité d’enjeux et de possibilités trouve son écho chez le même réalisateur dans l’incontournable Goodfellas (Les Affranchis), sorti en 1990, comme un versant plus ambitieux et tout aussi sombre d’une vision enrichie de moyens et d’une maîtrise que Mean Streets ne pouvait revendiquer. A l’amitié s’ajoute la peur, peur d’être flingué par un ami de toujours, peur d’être pris par la police, peur d’être déconsidérer.
Goodfellas illustre mieux que n’importe quel autre long-métrage la frontière étroite entre les rêves et les cauchemars du gangstérisme new-yorkais, horizon détestable et désirable à la fois qui s‘évoque déjà sous la forme d’un témoignage, preuve que bien souvent c’est a posteriori que les enjeux se révèlent et que les protagonistes prennent la pleine mesure de ce qui se trame. Le film de gangsters a tout d’une fuite en avant, tragédie des temps modernes, et à ce titre le film de Martin Scorsese a tout d’une référence canonique.

Du témoignage et de la tragédie naît une mélancolie souvent dissimulée des films de gangsters, faiblesse incompatible avec la virilité et l’ego surdimensionné des porte-flingues italo-américains aux costumes d’un autre temps. Dans la continuité de l’œuvre de Scorsese, A Bronx Tale, réalisé par Robert de Niro lui-même en 1993, dresse le portrait de cette tristesse sourde.
Dans l’affrontement de deux figures paternelles, A Bronx Tale n’est plus un film d’affirmation mais un film d’apprentissage, au protagoniste pris entre deux idéaux. Robert de Niro livre un choix surprenant, puisqu’il n’est pas d’incompatibilité qui tienne entre Bien et Mal, entre légalité et gangstérisme et entre un père et un père de substitution, mais qui porte en lui la richesse des interrogations de son personnage principal.
Et si A Bronx Tale se dévoile au-delà du gangstérisme par son regard sur le racisme et les ghettos new-yorkais, il s’agit là du signe que le drame du films de gangsters est un environnement. New-York dans sa diversité crée les conditions de sociétés parallèles en son sein, terreau à la fois des gangsters et des affrontements intercommunautaires. A ce titre, A Bronx Tale s’affranchit quelque peu de sa forte inspiration scorsesienne et empreinte largement à Spike Lee, déjà beaucoup évoqué dans cette série.

Par les films de gangsters se dévoilent ainsi les facettes de la diversité new-yorkaise, bien au-delà des inévitables figures italo-américaines, tant dans les rangs des gangsters eux-mêmes que de ceux qui s’y opposent, avec pour fil conducteur une certaine forme de fatalité.
Year of the Dragon, réalisé par Michael Cimino ouvre le portrait chinois de New-York façon gangster par un affrontement entre triades de Chinatown et un officier de police d’origine polonaise.
Avec lui, c’est la question de l’identité, de l’assimilation qui est mise en opposition de traditions millénaires et d’une forme de statu quo, dans un rapport qui résonne curieusement à l’aune des réflexions contemporaines. Le gangstérisme y devient la réponse à un devoir d’appartenance, et la légalité un paradoxal renoncement, symbolisé par le choix du protagoniste d’abandonner son nom à consonance polonaise. Year of the Dragon interroge la modernité d’une pratique, illustre un rapport historique entre New-York, la mafia et le cinéma, héritage dont on ne sait s’il faut en être fier ou le remiser au placard d’un passé sombre et barbare.

Le portrait chinois du New-York du gangstérisme se poursuit à travers le triptyque d’un réalisateur malheureusement trop tardivement reconnu.
Loin de Chinatown, et des Little Italy, James Gray s’est attaché à montrer Little Odessa, quartier russophone aux confins de Brooklyn, et connu par certains pour abriter Coney Island.
Little Odessa, premier opus du trio, illustre avec dureté l’écrasant poids de la solitude et du jugement qu’accompagne la vie d’un tueur à gages rejeté par sa famille et qui renoue les liens avec son petit frère.
Dans la froideur de l’hiver et la lumière jaune des lampadaires, le film montre la tristesse d’une condition aux antipodes du romantisme scorsesien. Les gangsters y sont maudits, et leur pouvoir n’est qu’illusion une fois tenu compte les sacrifices concédés pour y parvenir. La communauté est ici non plus un abri mais un foyer inaccessible qui s’est refermé depuis longtemps déjà. Les fils prodigues n’y sont pas accueillis à bras ouverts, point de rédemption possible, et chacun en est réduit à aller avec sa peine.

Inspiré par le mythique On the Waterfront d’Elia Kazan, The Yards présente le volet politique du film de gangsters new-yorkais, car la corruption ici autant qu’ailleurs irrigue les portefeuilles des politiciens pourris. James Gray se fait le compteur d’un scandale ferroviaire new-yorkais où l’on tue pour obtenir des contrats, et où le rapport à la vertu est sans cesse menacé par l’humanité même des personnages.
The Yards, en plus de renvoyer dans le même camp les corrompus et les corrupteurs place le dilemme moral au cœur des enjeux du film de gangsters, assorti d’un rapport à la famille qui empêche un choix totalement libre, dans une combinaison tout-à-fait traditionnelle du genre, sans pourtant que les personnages ne contrôlent leur propre destinée.

We Own the Night, dernier volet du triptyque, opère la synthèse de cette combinaison et de la lourdeur froide et morbide des bas-fonds new-yorkais. Le protagoniste y est un trait d’union impossible entre la pègre et la police, trait d’union impossible entre deux facettes opposées de la communauté russe new-yorkaise, dont il abandonne lui-aussi l’héritage en renonçant à son nom.
We Own the Night est le symbole du choix que doivent opérer les personnages saisis entre deux mondes comme les films de gangsters en produisent si souvent. À la rencontre entre le mythe capitaliste du succès financier et un héritage historique où les identités immigrées rencontrent une nouvelle identité fabriquée, le film de James Gray place ses enjeux dans un environnement new-yorkais, au-delà même des considérations géographiques. C’est dans cette alternative que se montre une part de l’histoire new-yorkaise et qui explique en partie pourquoi New-York plus que nulle part ailleurs est le théâtre privilégié du film de gangsters.

Alors, dans la mesure où la New-York historique trouve un aboutissement dans l’érection de mythes, il est nécessaire de s’attarder sur le rapport du film de gangsters à l’histoire de New-York, en un film fleuve qui résume tout.
Once Upon a Time in America, chef-d’œuvre de Sergio Leone, fait des zones d’ombre du récit new-yorkais l’enjeu d’une épopée du gangstérisme, fable géante d’un échec dont on ne sait bien jusqu’où il s’étend. De la Prohibition au retour désabusé, de l’enfance rêvée au drame amoureux, du passage à l’âge adulte manqué au deuil impossible, il illustre combien le destin du gangster new-yorkais a tout de l’anti success story.
Au contraire des grands mythes fondateurs du cinéma américain, exprimés notamment en quelques westerns de légende, L’Homme qui Tua Liberty Valance de John Ford et Il Etait une Fois dans l’Ouest du même Sergio Leone en tête, Once Upon a Time in America ne consacre pas un triomphe du droit et de la civilisation, mais une série de ratés d’un personnage qui n’a jamais su trancher le dilemme moral, qui n’a jamais su démultiplier son ambition ou canaliser ses élans.

Le film de gangsters est une éducation, à la dureté du monde, à la complexité des relations de confiance, aux jeux de pouvoir, à la tromperie, à la morale appliquée. En cela, il est un récit fondateur de la nation américaine et évolue dans un univers symbolique chargé d’une certaine nostalgie. Dans ce contexte, New-York se fait l’écho des doutes qui accompagnent ce récit et des questions qui subsistent encore autour du mythe.
Le film de gangsters sert une vocation hagiographique, variante sombre du succès à l’américaine, triomphe final de l’ordre et de la justice, sauf lorsque le mythe se souvient qu’il est des histoires dont personne ne sort vainqueur et que les bas-fonds, New-York et les Etats-Unis ont détruit peut-être autant qu’ils n’ont construit.

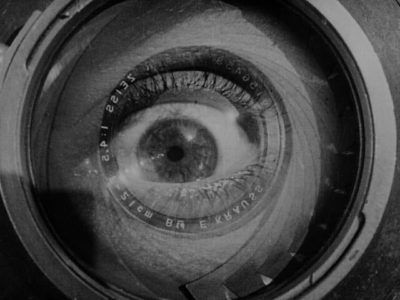




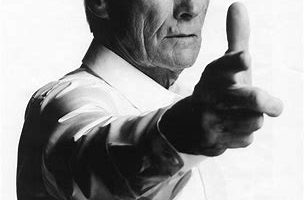








Comments