Athena nous arrive pris entre deux feux, attaqué à la fois par la droite sécuritaire et la gauche culturelle pour des raisons étonnamment similaires. Dans les deux camps, le jeu sur l’ensauvagement des banlieues, peur et fantasme inavoué des réactionnaires, ne parvient qu’à agacer. Il serait possible de répéter à travers ces lignes ce qui a déjà été dit partout, c’est-à-dire que le film souscrit malgré lui à un imaginaire plus proche de Reconquête que de la France Insoumise, que les banlieues y sont des zones de non droit, dominées par une jeunesse sanguinaire et hystérique, incapable de communiquer autrement qu’en hurlant. On pourrait aussi mentionner à nouveau ces survêtements qui font office d’uniformes, et qui servent à anonymiser des hordes de racailles réduites, comme dans Bac Nord, à des bêtes sauvages. Mais plutôt que de lister pour la énième fois ce qui fait d’Athena un affreux naufrage politique, il est sans doute plus intéressant de regarder comment et pourquoi ce ratage a été rendu possible, quelles sont les causes qui font qu’une équipe qui s’imagine produire un film de gauche aboutit à un résultat adhérant à ce point aux thèses de son adversaire.
La banlieue et le cinéma français partagent une longue histoire commune, dont le représentant le plus emblématique est indubitablement La Haine, sorti en 1995. Déjà à cette époque, il s’agissait de construire les enjeux du film autour d’une bavure policière, cause centrale de la violence qu’on retrouve dans Les Misérables et Athena, tous les deux écrits par Ladj Ly. Pourquoi la bavure ? Parce qu’elle représente une méthode facile pour décrédibiliser la police, jeter les banlieusards dans les rues et faire monter la tension. La bavure, c’est l’évènement qui supplante le social. Plutôt que de montrer les conditions quotidiennes d’une existence précaire, elle offre une justification expéditive à l’escalade de la violence. Ni Athena, ni Bac Nord, ni même Les misérables, ne montrent les adultes travailler, l’attente devant le premier métro alors qu’il fait encore nuit, les journées répétitives pour un salaire de misère. Ce cinéma-là ne s’intéresse pas au réel, tout juste le relègue-t-il à l’arrière-plan en lui accordant une courte scène de compassion, avant de passer à ce qui le fascine vraiment : l’affrontement.
Ce n’est pas pour rien que le titre du film de Romain Gavras fait référence à la mythologie grecque. Si sa musique adopte les codes des chants martiaux antiques, si la prise d’un pont par les CRS est filmée comme l’assaut d’une forteresse d’heroic-fantasy, si Karim se présente torse nu comme un guerrier légendaire, c’est que la banlieue est d’abord un terrain de jeu abstrait. Saturée par les images des actualités, elle représente pour les spectateurs autant que pour certains des réalisateurs qui s’en emparent le dernier espace exotique de leur pays, inaccessible et mystérieux (les fameux « territoires perdus de la République »). C’était sur ce terrain-là que jouait Bac Nord, faisant de ces barres d’immeubles bloquées par les trafiquants la source d’un fantasme que seul le cinéma était en mesure de forcer, pour qu’enfin il soit possible de voir. Il s’agit alors de visiter les quartiers comme dans un safari, d’observer les prédateurs derrière la vitre. Or, peu importe au touriste à l’arrière de sa jeep que les lions dorment 14 heures par jour, lui veut les voir chasser, il veut en avoir pour son argent. Comme Jimenez et Gavras, le réalisateur n’a plus à penser, mais à servir bêtement la soupe spectaculaire que les curieux sont venus chercher. Ce désir de folklore grandiloquent débouche sur Athena et ses (plans) séquences qui ressemblent plus à des rediffusion de feux d’artifices ou des bandes démos de chef opérateur qu’à de véritables scènes de film.

Que ces visions fantasmagoriques d’une banlieue illusoire soient mises en scène par des réactionnaires obsessionnels ou des bourgeois bohèmes en mal de sensations fortes s’explique encore, mais il faut noter que Ladj Ly officie au scénario d’Athena, lui qui a grandi dans un quartier similaire. Le cas Ladj Ly est justement très intéressant : déjà dans Les Misérables, il paraissait faire de son mieux pour étouffer son point de vue personnel. Résolument anti-policier, soutien actif d’Assa Traoré, il tournait son film du côté des forces de l’ordre, faisant tout son possible pour générer de l’empathie à leur égard. C’est aussi le cas d’Athena, où un CRS joué par Anthony Bajon se retrouve malgré lui plongé dans le chaos, des traces du vernis de ses gamines collées sur les ongles. Sans même mentionner l’hallucinant twist final, il y a quelque chose de paradoxal dans l’écriture du cinéaste. Comme s’il fallait rassembler, brosser le public dans le sens du poil, trouver dans la police un point d’accroche permettant in fine à l’audience de réaliser l’étendue de la crise des banlieues. Sauf qu’à force d’abonder dans cette direction, ses scénarios ne prennent jamais le virage attendu, et ils en restent à la surface de policiers dépassés, attaqués par des gosses ingérables.
Mais peut-on vraiment lui donner tort ? Des films comme Athena, Bac Nord ou Les misérables sont de véritables phénomènes médiatiques, alors que Bonne mère de Hafsia Herzi, sur le quotidien d’une quinquagénaire des quartiers Nord de Marseille, est passé totalement inaperçu l’année dernière. Il faut donc croire que la police est l’accroche nécessaire d’un public tellement abreuvé d’actualités télévisuelles qu’il ne croit plus à la banlieue qu’enragée. Étant donné qu’elle ne lui est offerte à voir que dans l’effervescence d’un conflit, il ne peut se l’imaginer qu’ainsi, et refuse donc de la voir autrement. Que la colère des habitants à l’origine dudit conflit soit justifiée par le film (comme dans Les Misérables, et de manière plus ambiguë/maladroite dans Athena) ou pas (comme dans Bac Nord) ne suffit pas à déterminer un quelconque placement politique. Le rôle du cinéma ne devrait pas être de radicaliser les reportages de BFM TV, mais de leur construire un contre-champ, de filmer ce qu’on ne nous laisse pas voir ailleurs. Pour ça, il y a L’esquive d’Abdellatif Kechiche, Wesh Wesh qu’est-ce qui se passe de Rabah Ameur-Zaïmeche, ou encore Le Thé au harem d’Archimède de Mehdi Charef. Autant de films qui ont préféré le vécu à la dramatisation, quitte à ne pas faire assez de bruit pour déclencher des vagues d’indignations chez les lecteurs de Laurent Obertone : on ne peut pas tout avoir.


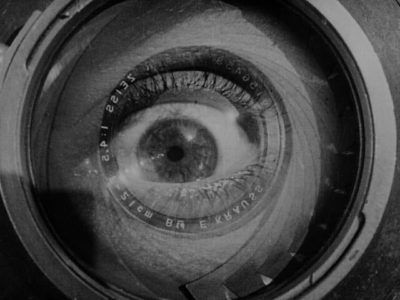




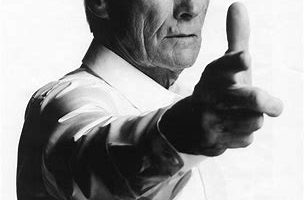








Comments