New York est une ville de fantasmes, à croire qu’il y a 2000 ans déjà elle inspirait la Babel biblique et avec elle sa destruction. De cette aura quasi mystique naît un objet de fiction, et New York devient la Ville. La ville d’une interminable verticalité, la ville de la noirceur crasse, la ville de la lutte des classes, la ville de la lutte pour la justice, la ville du surhumain.
Du surhumain au superhumain, New York a donc une place particulière, et c’est dans ce contexte qu’elle donne lieu à l’affrontement de forces immenses et d’antagonistes terrifiants. A la croisée de ces dimensions, New York est Gotham, surnom devenu alter ego, mise en image symbolique et terrain de jeu de Batman, de ses acolytes et de ses adversaires, Joker, Pingouin, Catwoman et compagnie.
La naissance de Batman au cinéma, en 1966, pose les bases de la dimension centrale de Gotham, phare du monde, temple de l’ordre des Nations Unies. Batman : le film dévoile ainsi un affrontement manichéen dont Batman n’est pas encore le trait d’union, entre le clair et l’obscur, mais au contraire le symbole de l’ordre triomphant, à l’image d’une ville mise à l’image dans toute sa clarté et qui tranche tellement avec les autres adaptions du chevalier noir.
Dans les balbutiements de la franchise au cinéma, et malgré les esthétiques datées, c’est aussi le rapport à la modernité qui naît. Gotham n’est pas seulement le phare d’une synthèse des valeurs occidentales mais aussi la référence d’un avancement technologique, le champ de l’expérimentation, en Bien comme en Mal. Dans cette dualité, Gotham est déjà le terreau fertile du développement d’un personnage parmi les plus emblématiques dont les comics et le cinéma aient accouché.

Le bond en avant qui sépare Batman : le film et la deuxième déclinaison cinématographique du chevalier noir, Batman, réalisé par Tim Burton et sortie en 1989, est considérable, et c’est avec lui qu’on mesure combien Gotham et son mythe ont pris en ampleur.
Ampleur esthétique, puisque la ville devient le synonyme de l’obsession burtonienne pour l’expressionisme allemand, entre obscurité, rapport torturé à la verticalité, au corps, voûté, défiguré, transformé. C’est avec Batman que Gotham devient Gotham dans l’esprit du public.
Ampleur d’un personnage, tant Batman dévoile Bruce Wayne, milliardaire justicier obsédé par la mort de ses parents. Gotham est une ville de déracinés, de malheureux, derrière les masques et les sourires de façade, des mots même du Joker, Jack Nicholson de gala pour l’occasion. Batman lance le mystère d’une identité, inconnue des personnages mais connue des spectateurs et avec lui c’est Gotham qui montre son univers trouble.
Ampleur d’une réflexion morale, puisqu’enfin Batman gagne son ambiguïté vis-à-vis de la loi, de la justice, à mesure qu’il prend son ampleur de super-héros.
Le Batman de Tim Burton porte donc en lui l’apogée d’un mythe et offre à ses successeurs la difficulté d’une perpétuation ou d’une réinterprétation, heureuse ou malheureuse.

Le second volet de Batman selon Tim Burton, Batman Returns, sorti en 1992, présente déjà les effets de cette difficulté, dans la répétition des interrogations de son protagoniste et dans la prépondérance absolue de l’antagoniste comme baromètre de la qualité d’un film.
Avec le Pingouin, Gotham révèle qu’en plus d’être une ville des sommets, elle est avant tout un égout habité par la masse des « Gothamites » bons ou mauvais, et non pas seulement par les ersatz de gangsters façon film noir du premier film de Tim Burton. Batman Returns amplifie le malheur d’une ville, déshumanise peu à peu Gotham en miroir du Pingouin et pour la première fois use de la multiplication des antagonistes pour multiplier les discours. Max Schreck, en plus de porter le nom du premier interprète de Nosferatu, incarne le rejet de l’inhumanité capitaliste, dont Bruce Wayne est lui-même un représentant ambigu, Catwoman interpelle quant à la place des femmes dans un univers aussi inhospitalier et viriliste.
Batman Returns procède ainsi paradoxalement d’une remise au centre des préoccupations contemporaines et d’une Gotham qui ressemble de plus en plus à New York, malgré la vampirisation de son esthétique par Tim Burton, au risque d’abandonner l’esprit pulp du matériau d’origine.

Après l’âge d’or survient la chute, et Batman au cinéma ne fait pas exception. La reprise en main de la franchise par Joël Schumacher est en effet tristement célèbre pour avoir assassiné Batman, Gotham et l’esprit des films de super-héros, mais c’est aussi dans ses écarts qu’elle est révélatrice de l’esprit de l’œuvre dans sa globalité.
Batman Forever, sorti en 1995, troque l’esthétique expressionniste pour un fatras de couleurs vives, surplombées toujours par l’immanquable noirceur du ciel de Gotham et de cette évolution visuelle découle une évolution du traitement des personnages, dont la simplicité n’a d’égale que la médiocrité.
Cela étant dit, Batman Forever a le mérite d’étendre légèrement l’ambiguïté propre à Batman/Bruce Wayne à l’entièreté des représentants de l’ordre de Gotham, par l’intermédiaire d’un Harvey Dent/Double Face complètement massacré, au-delà de la corruption très présente chez Burton, vers les espoirs déchus. Gotham n’est pas seulement le signe d’un malheur mais aussi le signe d’un échec, renversement et réappropriation de l’origine new-yorkaise de la ville de fiction.
Batman Forever met enfin en question la symbolique même de la chauve-souris, pour rappeler qu’avant tout Gotham est unifiée par la peur et que c’est là probablement plus qu’ailleurs que tous les personnages trouvent leur motivation.

Batman & Robin lui, ne s’embarrasse plus d’étendre les mythologies ou de questionner les mythes. Sorti en 1997, il signe la mort de Batman auprès du public, tant il est décrié, à raison, pour sa stupidité et sa déconstruction du personnage. Gotham n’y est plus qu’un joyeux bordel aux airs de paradis pop-punk pour adolescents fans d’Avril Lavigne.
Dans sa défiguration des symboles, il parvient donc à faire perdre à la franchise Batman sa froideur, malgré l’apparition de Mister Freeze en antagoniste et à lui faire perdre sa classe, déjà bien entamée dans le précédent opus.
Dans le cataclysme qu’il représente, Batman & Robin a toutefois le mérite de montrer que la force des symboles est ce qui fait l’intérêt de Batman et de Gotham, de cet immuable ballet de gadgets dans les ruelles fumantes d’un New-York de studio, et c’est finalement c’est toujours ça.

La trilogie Batman par Christopher Nolan a su, malgré l’effondrement qui l’a précédée, faire renaître les mythes Batman et Gotham grâce à un retour aux fondamentaux accompagné d’une modernisation et une vaste mystification.
Batman Begins, sorti en 2005, inaugure une Gotham qui n’est plus New-York, mais Chicago, où l’essentiel du film a été tourné. Mystification ultime que de perpétuer le symbole au-delà de la réalité visuelle.
Mais ce mensonge à l’image s’accompagne paradoxalement d’un retour de Batman les pieds sur terre, dans un objectif de réalisme cru inédit, en phase avec l’évolution des sagas d’action, Jason Bourne ou James Bond en tête, qui peut sembler inapproprié pour un film de super-héros mais qui dans les faits se traduit par un accroissement des enjeux et des menaces bienvenu. L’alliance de la froideur des personnages et de la froideur d’une esthétique qui fait remarquer qu’aussi sombre soit-elle, celle de Tim Burton faisait preuve d’un flamboyant parfois mal à propos, permet à Batman Begins de renouveler le théâtre de l’action, de le construire par opposition aux forces ancestrales qui entrent en opposition, incarnées par Ra’s Al Gul.
C’est la sobriété caractéristique de Christopher Nolan qui donc met le mieux en exergue la sobriété relative de son héros et avec elle sa spécificité.

La suite de Batman Begins, The Dark Knight, sortie en 2008, constitue l’aboutissement de la démarche entamée par Christopher Nolan. Aboutissement de la réflexion d’un Batman philosophe mis aux prisew d’un antagoniste nihiliste et cultissime, aboutissement d’un jeu à plusieurs avec l’émergence d’Harvey Dent comme le visage ambigu d’un idéalisme défiguré par l’amour, aboutissement enfin du mensonge, sur le lieu, les coupables, les circonstances.
The Dark Knight marque un degré d’ambiguïté inégalé et qui a fait sans aucun doute son succès. Il assume enfin les spécificités de Batman au sein de la galaxie des super-héros et réinvente le genre, tant 13 ans après sa sortie son influence se fait encore ressentir.
Il exorcise également les tracas d’une nouvelle époque, à travers la figure du Joker, qui est tout sauf un Ben Laden maquillé, et présente de ce fait le Mal pour le Mal et non comme un instrument d’action politique ou de purification, comme le faisait Ra’s Al Gul dans le précédent opus.
Gotham se met alors au service de cette volonté nouvelle du réalisateur de déplacer les enjeux narratifs. C’est l’inhumanité des gratte-ciels de verre qui est ici utilisée comme l’élément majeur du décor, en total décalage à la fois avec les dérives délirantes de l’ère Schumacher ou les deux films de Burton.

Une fois mis en évidence les partis pris de The Dark Knight, il est d’autant plus étrange de constater que la conclusion de cette trilogie et avec elle le dernier volet à ce jour des aventures de Batman en solo, loin des crossovers du DCEU, The Dark Knight Rises, sorti en 2012, revient en partie sur les avancées de l’ère Nolan.
La réception relativement tiède de cet opus reflète le rejet d’un retour. Retour à New-York, actant le fait que Gotham reste bel et bien là où elle a toujours demeuré, retour aussi aux plans de destruction du monde, de meurtres de masse et autres réjouissances, pourtant éculés.
The Dark Knight Rises illustre les limites morales du manichéisme de Gotham et montre que la ville et Batman ne peuvent pas représenter une force salvatrice, comme si les questionnements perpétuels du chevalier noir accouchaient d’une réponse incongrue pour un film américain, l’absence de but, de moteur moral. Gotham est un lieu immoral, et par conséquent, on ne peut attendre de Batman qu’il soit le parangon de la morale kantienne, qui appartient aux personnages secondaires, Robin en tête, véritable point fort du long-métrage.

Si la trilogie de Christopher Nolan nous apprend quelque chose, c’est avant tout le pouvoir d’évocation de Batman et de Gotham en miroir des préoccupations du spectateur, dans la lignée de l’essence des films de super-héros et de leur visée cathartique, avant que le grand spectacle n’emporte tout sur son passage.
Les films Batman perpétuent la tradition vieille d’un siècle de la New-York mystifiée qui révèle les écarts d’un monde, et convoquent un véritable héritage de cinéma. Gotham est la Metropolis des temps modernes et c’est dans la reprise de l’œuvre de Fritz Lang, classique absolu du cinéma muet sorti en en 1927, que se révèle l’ampleur de l’œuvre, de l’opposition entre tréfonds et cimes, du rapport à la modernité, du cynisme des savants fous, du rapport aux parents, à la perte, au Bien et au Mal, à la justice, à la question sociale.
Batman est devenue une dystopie, voilà sa particularité, voilà son héritage.

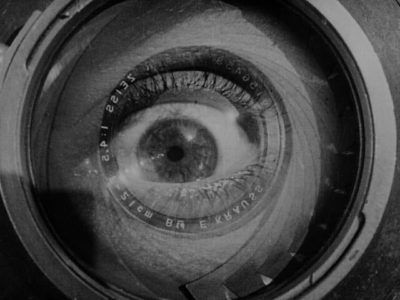




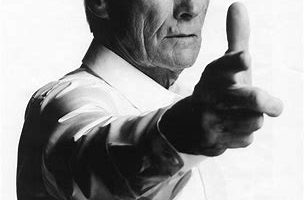








Comments